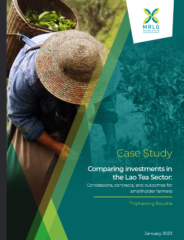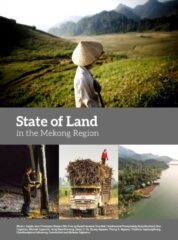Laos
L’historique foncière du Laos, mais aussi des pays voisins du bassin de Mekong (Vietnam, Cambodge, Thaïlande et Birmanie) est d’abord marquée par (i) la diffusion de la propriété privée et des concessions à l’époque coloniale, puis (ii) l’étatisation et le collectivisme, (iii) la redistribution (parfois égalitaire) des terres durant la période post socialiste, (iv) le retour de la propriété privée (ou d’un droit d’usage très étendu) via l’enregistrement des terres et, (v) l’attribution de concessions à des investisseurs nationaux et étrangers depuis les années 2000.
Chacune de ces périodes a largement modifié l’accès et le contrôle des terres par les communautés locales. Si pendant des siècles, les communautés locales géraient les ressources communes au profit de tous les membres, disposaient de règles et réglementations locales spécifiques pour la gestion des ressources naturelles, la révolution de 1975 a été un tournant décisif. Le Pathet Lao a instauré une économie planifiée collective et la propriété des terres est transférée aux représentants de l’État. Des coopératives ont été créées et une mutualisation de la main d’œuvre et des terres agricoles a prédominé. Toutefois, l’initiative a été un échec et le pays a connu des famines. Après onze années d’insuccès, le Laos s’est engagé en 1986 sur la voie de l’économie socialiste de marché. Dans le même temps, des politiques de relocation des villages éloignés vers les zones basses entraînent le mouvement de milliers de foyers vers les axes de communication, entraînant une pression foncière élevée sur les terres allouées.
Dans les années 1990, les terres villageoises coutumières ont été de plus en plus menacées, en particulier à cause de la mise en œuvre du programme national de stabilisation de l’agriculture itinérante, qui a été déployé par le biais d’activités d’allocation de terres et de forêts (Land and Forest Allocation) entre 1994 et 2006. Le programme visait à améliorer la sécurité foncière pour stimuler l’investissement, à inciter les communautés à protéger l’environnement et à accroître les recettes fiscales (via les titres fonciers). Comme l’allocation de terres avaient touchés environ 50% des villages laotiens, elles ont eu des impacts étendus sur l’utilisation collective des terres, contribuant à un accès réduit à la terre et aux ressources naturelles ainsi qu’à l’insécurité alimentaire d’une grande partie des ménages.
Dans les années 2000, la propriété privée et la libre entreprise deviennent les nouveaux principes économiques. Le gouvernement mise sur un développement agricole intensif et moderne pour approvisionner le marché intérieur, assurer les exportations et voir émerger un tissu agro industriel national. Suivant le moto « Turn land into capital », le gouvernement lao a opté pour une libéralisation du marché foncier dans le cadre d’une économie de marché de type néolibérale. Il a attribué de nombreuses concessions foncières à des investisseurs nationaux et étrangers. Un programme de titrisation des terres dans les zones urbaines et péri-urbaines a été établi, avec le soutien technique et financier de la Banque Mondiale et de la Banque Asiatique de Développement. Toutefois, la grande majorité de ces zones de concession chevauchent des terres communautaires, provoquant ainsi une augmentation des conflits fonciers et menaçant les moyens de subsistance des ménages ruraux. De plus, qu’ils disposent ou non d’un titre d’accès ou d’utilisation, les villageois ne peuvent pas protéger leurs droits. En réponse aux impacts environnementaux et sociaux de ces concessions, le gouvernement a adopté un moratoire temporaire sur l’allocation de nouvelles concessions.
Outre la Constitution de 2003 (amendée en 2015) et la loi foncière (2019), d’autres documents juridiques régissant l’administration foncière comprennent la loi forestière (2019), la loi sur la promotion des investissements (2009, en révision), le décret 192/PM sur l’indemnisation et la réinstallation (2005), et le décret 135/PM sur la location ou la concession des terres de l’État (2009). La nouvelle loi foncière reconnaît les droits fonciers coutumiers en principe, mais la reconnaissance en pratique de ces droits en zone forestière sont encore en cours de discussion (voir en particulier Customary Tenure Rights under the Land and Forest Laws in Lao PDR – MRLG)..