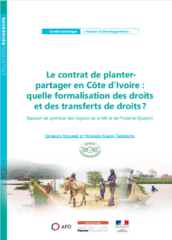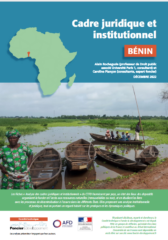Côte d’Ivoire
La situation foncière en Côte d’Ivoire est fortement marquée par d’anciennes et intenses migrations agraires, notamment dans la zone forestière, et par un compromis institutionnalisé passé dès les années 1950 entre le régime et les différentes composantes de la société. Durant cette période de prospérité économique, ce compromis se traduit par le choix d’une politique libérale accordant des facilités aux entreprises étrangères en termes d’investissement et de fiscalité (en échange d’un soutien politique et financier), l’approfondissement de la spécialisation du pays dans l’exportation du café et du cacao, ainsi que l’ouverture des frontières aux capitaux étrangers et aux hommes, notamment à travers le recours à une abondante main d’œuvre étrangère en provenance des pays voisins. En contrepartie, l’accès à la terre est facilité pour tous ceux qui souhaitent la mettre en valeur, des investissements publics importants sont réalisés dans toutes les régions du pays et les prix agricoles sont garantis grâce à la caisse de stabilisation.
Ces choix initiaux ont longtemps été « payants » dans la mesure où la Côte d’Ivoire a bénéficié durablement d’un environnement international favorable. Cependant, après l’euphorie des années 1970, l’économie est prise en tenailles entre une dette explosive et des recettes à l’exportation frappées par la chute des prix internationaux. La Côte d’Ivoire est alors soumise à des plans d’ajustement structurel : privatisation des sociétés publiques, assainissement budgétaire, et désengagement à marche forcée de l’État, sans prendre en compte les arrangements économiques et institutionnels pré-existants.
Faute d’être en mesure de réinventer de nouveaux compromis nationaux, la classe politique ivoirienne va alors suivre une dérive ethno-nationaliste qui prendra toute son ampleur dans les années 1990 avec la promotion de « l’ivoirité » fournissant le référentiel de l’exclusion des « étrangers » – dans une acception large – qui avaient pourtant été les chevilles ouvrières du développement national. Le foncier deviendra très vite la pierre angulaire de cette rhétorique.
La loi sur le domaine foncier rural, publiée le 23 décembre 1998, organise le titrage systématique des droits coutumiers en droits de propriété privé. Depuis le premier coup d’Etat de décembre 1999, sa mise en œuvre a été régulièrement retardée, d’autant plus que l’application systématique de politiques de formalisation des droits coutumiers sous forme de titres de propriété privée est très controversée.
Certaines dispositions de la loi contribuent en effet clairement à attiser les tensions latentes. Elles consacrent l’exclusion des non-ivoiriens de la propriété foncière, alors que, dans la zone forestière, une partie importantes des exploitants sont des non-nationaux qui ont accédé à la terre par des transactions avec les « propriétaires terriens » coutumiers autochtones. Dès sa promulgation, la loi a donné lieu à une information partisane déformée et à des interprétations contradictoires qui ont contribué à attiser les tensions foncières intercommunautaires.
Face à ces difficultés, la législation a finalement fait l’objet de plusieurs modifications successives en 2004 (maintien des droits acquis avant 98), 2013 (modification relative au délai de 10 ans accordé pour la contestation des droits coutumiers), et 2019. Ces dernières consacrent le statut légal du certificat foncier comme un acte administratif de constations des droits coutumiers, le titre foncier restant l’unique preuve de la propriété foncière en milieu rural. Elles suppriment le délai de 3 ans pour immatriculer les terres objet de certificat foncier, tandis que le décret du 5 avril 2023 le fixe à 10 ans. Une Agence foncière rurale (AFOR) est par ailleurs créée pour conduire la procédure nationale de certification, avec l’appui de nombreux bailleurs de fonds (UE, AFD, Banque Mondiale). Après plus de deux décennies de mise en œuvre, l’état des lieux de la sécurisation foncière en Côte d’Ivoire est toujours marqué par de nombreuses controverses et est aujourd’hui menacé par la montée des tensions dans les territoires en lien avec l’extrémisme violent.
Cadre juridique et institutionnel Côte d’Ivoire