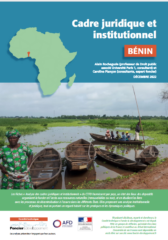Niger
A l’indépendance du Niger, l’Etat a réformé la politique foncière et les modalités de gestion des ressources naturelles héritées de la période coloniale. Différentes dispositions ont été prises pour limiter le rôle de la chefferie traditionnelle dans l’attribution des terres et favoriser un accès équitable des agriculteurs et des éleveurs nigériens aux ressources naturelles, en reconnaissant la propriété coutumière des champs et en instaurant une « zone pastorale », réservée à l’élevage, au Nord du pays.
Le président Seyni Kountché, arrivé au pouvoir suite à la sécheresse de 1973, a continué dans cette logique en affirmant que : « la terre appartient à celui qui la travaille » (déclaration du 18 décembre 1974). Dans l’objectif d’empêcher de nouvelles crises alimentaires, il a lancé, dans les années 80, un vaste chantier de réflexion sur le développement rural.
Ces travaux ont débouché sur la mise en place du Code rural avec l’adoption en 1993 de l’ordonnance n° 93-015 fixant les principes d’orientation du Code rural. Cette ordonnance précise les objectifs assignés au Code rural : la sécurisation foncière des acteurs ruraux, l’organisation du monde rural, la gestion durable des ressources naturelles et l’aménagement du territoire.
La mise en œuvre du Code rural est un processus évolutif, articulé autour d’un dispositif juridique et d’un dispositif institutionnel : (i) le dispositif juridique repose sur l’ordonnance fixant les principes d’orientation du Code rural, complété par des textes sectoriels (eau, élevage, forêt, institutions, etc.) ; (ii) le dispositif institutionnel est composé d’institutions collégiales, présentes à tous les échelons administratifs et chargées de la mise en œuvre du Code Rural.
Ce dispositif se caractérise par : (i) la reconnaissance des droits coutumiers de propriété et la mise en place d’un service de proximité (les Commissions foncières) pour les enregistrer ; (ii) la reconnaissance de la mobilité pastorale et la sécurisation des ressources pastorales ; (iii) une gestion locale et concertée des ressources naturelles impliquant tous les acteurs concernés (producteurs ruraux, chefferie traditionnelle, élus, autorités administratives, services techniques) et (iv) des outils de prévention et de gestion des conflits fonciers ruraux.
Les missions assignées au Code rural en 1993 sont plus que jamais d’actualité pour sécuriser les droits des producteurs ruraux et atteindre la sécurité alimentaire. En effet, la forte croissance démographique et les changements climatiques induisent une pression foncière accrue, tandis que les besoins alimentaires s’accroissent et que les risques de crise alimentaire augmentent. Cette tension sur le foncier entraîne des conflits, des phénomènes d’appropriation des ressources naturelles et la dégradation de ces ressources, ce qui freine indéniablement le développement rural. Différents textes sont adoptés par la suite pour tenir compte des enjeux de sécurisation du foncier pastoral et d’aménagement du territoire.
En 1997 sont publiés les décrets d’application des principes d’orientation du Code rural qui mettent également en avant la gestion et la mise en valeur des ressources naturelles, le statut particulier des couloirs de passage pour le bétail à l’échelle internationale, nationale, départementale et communale, le statut des puits en zone pastorale, la mise en place d’un schéma d’aménagement foncier intégrant la mobilité des troupeaux à l’échelle régionale. La Stratégie nationale de développement rural (SDR) est quant à elle publiée en 2004.
Les premières élections communales ont lieu en 2005 au Niger. La gestion des ressources pastorales, des points d’eau et couloirs de passage locaux sont intégrés dans le mandat communal. Les commissions foncières communales sont mises en place.
En 2010 est adoptée une Ordonnance sur le pastoralisme, publiée après plusieurs années d’investissement de la société civile pastorale. La mobilité pastorale est reconnue comme un droit de tous les éleveurs et des indemnisations des usagers sont prévues en cas d’expropriation ou d’exploitation exclusive.
Après un processus de concertation sont enfin organisés les États généraux du foncier rural du 13 au 16 février 2018, débouchant sur une feuille de route portant sur l’élaboration d’une politique foncière rurale. Celle-ci sera adoptée en 2019 pour intégrer les enseignements issus de l’évaluation des vingt ans du Code rural.